Interview
JB : Il faudrait choisir
quels traits retenir pour faire une sorte d’autoportrait.
Des traits professionnels ? Alors disons que j’ai passé l’essentiel
de ma vie comme professeur des universités, d’abord au Canada, à
Montréal, puis en France, à Aix. Mais j’ai commencé par un tout autre
rôle, celui de médecin, chef de laboratoire à l’Institut Pasteur, ce qui
m’a fait séjourner près de quatre ans à la Martinique. Tout cela après
des études à Lyon et à Paris qui m’ont conduit à une thèse de médecine,
puis plus tard à une thèse d’anthropologie.
Mes intérêts et curiosités ? Ils viennent à la fois de ma formation
médicale et scientifique et de ma formation anthropologique. Mais cela
ne dit que de façon simplifiée l’interrogation plus fondamentale qui me
hante depuis longtemps et qui est d’essayer de réduire l’écart entre
savoir et croire, entre comprendre et sentir. C’est ce qui m’a conduit à
explorer, dans la vie, dans la pratique de mon métier les domaines où
cela se recoupe : l’art, la religion, ces lieux où comprendre et sentir
vont ensemble. Et c’est aussi ce que j’ai essayé de faire dans mon
anthropologie, tout particulièrement à propos de la religion hindoue.
Mes rencontres en Inde et à la Réunion ont certes joué un grand rôle.
Mais aussi la rencontre avec le vécu de la maladie, le tableau de cette
confrontation solitaire à l’inéluctable qui efface le quotidien, qui
fait tomber le grand masque que nous croyons être notre visage et qui
nous cache l’éternité.
Et alors se posent les questions essentielles, celle du sens, celle
de la science et celle de la religion. Faut-il chercher et dire la
vérité, même si elle nous montre qu’il n’y a pas de sens ? Ou faut-il
trouver à tout prix un sens, même si cela pousse à des convictions qui
renoncent à la raison ? Les certitudes rassurantes doivent-elles être
démasquées, ou bien leur effet positif leur donne-t-il une autre
vérité ? Dans l’observation quotidienne du religieux, ces questions sont
toujours là.
Les croyants qui passent sur le feu, ceux qui sentent Dieu en eux
quand ils viennent de recevoir l’hostie, les parents de l’enfant mourant
qui le voient s’envoler vers le ciel, ne détiennent-ils pas eux aussi
une vérité ?
Alors, même lorsque je suis « anthropologue », c’est cela que je
cherche à comprendre et sentir. Et, ainsi que je l’ai écrit dans
Hindouismes créoles, « on ne croise pas impunément la religion des
autres » : elle déplace nos certitudes.
Ou alors pour compléter ce portrait faut-il évoquer ce que sont
pour moi les mondes créole et indien ? Je dirais que j’ai été « pris »
par ces sociétés, justement en tentant de les comprendre par la double
voie de la recherche et de la sensibilité. Observer, étudier, et en même
temps, s’attacher à des gens, des paysages, des goûts et des parfums,
des livres et des croyances, percevoir le sens des lieux, avec ceux qui
y vivent. Martinique, Réunion, Inde ont été de ces lieux. J’y ai associé
la recherche et la contemplation, l’amitié et la réflexion. C’est ce que
mes livres tentent de refléter, et plus particulièrement Paysans de
la Réunion et divers petits textes.
JB :
C’est une longue histoire, qui a
commencé début 1971. Longue histoire, parce qu’elle est la suite d’une
trajectoire qui remonte bien plus loin dans mon passé. Il y a mon
adolescence, l’époque où Lanza del Vasto , par son livre
Le Pèlerinage aux sources amorçait l’appel de l’Inde. Puis ce fut la
lecture des livres de Romain Rolland sur Vivekananda et sur Ramakrishna.
Mais surtout, vivant à la Martinique, j’y ai amorcé mon « aventure
indienne » : rencontre avec le petit groupe des Tamouls de la Martinique
(on disait alors « coolies ») et amitié solide avec l’un de ses membres
les plus instruits dans le domaine religieux, Joseph Tengamen, dit Zwazo.
Puis, toujours à la Martinique, rencontre lors de son passage avec le
fondateur de l’institut international des études tamoules, le jésuite
Thani Nayagan, que j’ai conduit chez Zwazo, et qui m’a ensuite invité à
Madras. Ma vie privée y a connu un tournant, par mon mariage en Inde,
qui m’a fait connaître à la fois certains aspects intérieurs d’une
société, son charme mais aussi ses barrières, son hostilité.
J’ai
ensuite utilisé un congé sabbatique de mon université canadienne pour
venir pour la première fois, en 1971, à la Réunion. Cette sorte de
symétrie avec les îles d’Amérique, alors fort peu étudiée, me fascinait.
J’ai lancé alors les premières réflexions sur la « société de
plantation » et cela a eu un écho local qui m’a encouragé à poursuivre.
C’est alors que l’université (à travers son président, Louis Favoreu) et
des organismes de développement (à travers leurs responsables, Edmond
Lauret et Michel Turquet) m’ont proposé de revenir pour une recherche.
Ce projet a commencé à La Réunion fin 1972 où je suis resté un peu plus
d’un an. Je me suis installé au plus près du monde rural, qui était
l’objet de la recherche, à Longuet, près de la Saline les Hauts. Cette
année passée « sur le terrain » a été le point de départ d’un lien
constant avec l’île, où je suis revenu chaque année pendant plus de
trente ans.
JB : Ce livre devait être
le bilan, le point final, croyais-je alors, de toutes ces années où
j’avais accumulé des notes, des photos, des enregistrements, des films.
J’avais écrit des articles, et participé à des colloques, à La Réunion,
à Maurice, en Inde, en France ; le moment me sembla venu de mettre tout
cela en ordre. Le coup de pouce m’a été donné par le Comité des Travaux
historiques et scientifiques qui m’en a promis la publication, sans
lésiner sur les illustrations et la dimension assez importante du
volume.
JB : Frappé ? Je ne sais.
Cela a plutôt été une imprégnation lente, l’apprentissage comme autant
d’évidences des pensées qui, quotidiennement, orientent la vie. On est
pleinement dans le monde créole. Mais il surgit çà et là d’autres
choses, qui d’ailleurs entrent à leur tour dans ce monde : références à
une divinité, valeur symbolique d’une couleur, d’une plante, d’un
aliment, sacralité d’un lieu, d’un temps de l’année, façons de vivre
l’alimentation, les relations dans la famille, le rapport à certaines
valeurs économiques et au travail. Rien qui « frappe », mais des
nuances, des colorations où celui qui connaît l’Inde retrouve un geste,
un objet, des paroles qui font écho à l’Inde. Mais qui sont naturels et
qu’on pourrait ne pas remarquer tant est grande leur fusion avec le
reste du quotidien.
Et puis, je dois mentionner une réflexion que je me suis souvent
faite, mais que je ne sais comment exprimer sans faire un détour. Que de
fois, en France ou ailleurs, ai-je été frappé par les sujets des
conversations : cela ne décollait pas des voitures, des femmes, des
sports ou des loteries. En milieu d’origine indienne à la Réunion, même
chez des personnes illettrées, qui avaient une vie très dure, c’était
autre chose – et j’ai fait la même constatation à Maurice. Les mythes,
même esquissés, les Dieux, les personnages du Mahabaratha et
leurs aventures étaient souvent présents ; on en parlait, on racontait
ce qu’on savait, on esquissait des pas de danse ou des chants. Que de
fois me suis-je dit que les responsables de la « culture » (au sens
« Ministère de la culture) n’arrivaient pas à toucher aussi fortement
les gens que ce qui venait du religieux hindou ! Et, depuis, les énormes
investissements qui ont été faits dans les fêtes, dans les temples, dans
les écoles de danse ou de langue, sont éloquents : la culture est là,
pas dans les opérations importées...
JB : Il y a plusieurs
niveaux à aborder dans cette question.
D’abord il ne faut jamais oublier que, pour l’essentiel,
l’hindouisme présent dans les îles est la forme populaire de
l’hindouisme, très vivante en Inde (où elle est en fait majoritaire).
Mais elle est liée aux groupes les plus défavorisés, aux castes les
moins élevées. D’où, en Inde même, une forte dévalorisation. Le
« discours brahmanique », celui que partagent les castes, et les
classes, supérieures traite une bonne part de l’hindouisme populaire
avec un réel mépris. Les indianistes classiques ont adopté à cet égard
la vision des groupes dominants. Férus de textes, ils ont également
ignoré cette part, essentiellement sans textes, de l’hindouisme. De plus
tout cela se double d’un sentiment de supériorité du « Nord » sur le
« Sud », d’où viennent avant tout les immigrants de la Réunion.
D’ailleurs, à Maurice comme à la Guadeloupe, où il y a eu des immigrants
des deux pôles du pays, la même différence de prestige se perpétue au
détriment des Tamouls et des autres originaires du Sud.
Que les indianistes méconnaissent ces dimensions des cultes est
donc assez « normal » car l’hindouisme pour eux est celui des textes.
Par contre, les anthropologues, qu’ils soient Indiens ou étrangers, ont
beaucoup étudié ces cultes populaires au cours des dernières décennies ;
ils faisaient suite en cela aux missionnaires des siècles passés, qui,
au contact des populations, ne pouvaient pas les ignorer et qui ont
laissé parfois des livres fondamentaux. J’en ai beaucoup lu ; la
bibliographie et les comparaisons que j’ai faites dans Hindouismes
créoles permettent de montrer combien l’hindouisme populaire
réunionnais est fidèle à ses sources indiennes, contrairement à bien des
affirmations locales qui le caricaturent.
Et cela nous conduit au second point, qui concerne la Réunion
elle-même. Il est un peu délicat d’en parler mais on ne peut l’éviter.
Un certain nombre de jeunes Réunionnais curieux d’en savoir plus sur la
religion de leurs ancêtres sont allés se former auprès des indianistes.
Ils ont fait un rude effort. Mais cet effort les a conduits sur une
fausse voie : ils ont rencontré l’hindouisme classique, celui des grands
textes sacrés, des brahmanes. Comparant cela avec ce qu’ils voyaient
dans leur propre pays, ils en ont conclu, avec l’assentiment de leurs
maîtres, qu’il s’agissait de formes dégénérées, altérées par des
mélanges et des oublis, maintenues par des ignorants. Et ils se sont
tournés vers l’Inde pour réintroduire (croyaient-ils, mais en réalité
pour importer) un hindouisme plus conforme à son image classique.
Peu à peu cependant, les
choses semblent s’ajuster. Une certaine continuité s’établit. Il est
évidemment normal qu’une population instruite et aisée tente de cheminer
plus avant au sein d’une religion dont ses ancêtres ne détenaient qu’une
forme liée à leur statut de travailleurs et de paysans pauvres. Mais en
même temps, ce qui vient des ancêtres est de moins en moins rejeté, car
on comprend mieux qu’il ne s’agit pas d’un pseudo-hindouisme mais d’un
« niveau » de l’hindouisme, un niveau aussi authentique que le niveau
supérieur. Avec Hindouismes créoles j’espère avoir un peu
contribué à cet ajustement. Aux Antilles, les choses se déroulent de la
même façon, et je l’ai abordé avec quelques collègues dans un livre paru
en 2004 (L’Inde dans les arts de
la Guadeloupe et de la Martinique, Cayenne, Ibis Rouge). Nous avons
examiné la question en partant des activités artistiques liées à la
religion (musique, danse, sculpture etc.) et en montrant comment les
arts récents, importés de l’Inde rencontrent les formes populaires
venues anciennement de l’Inde avec les engagés.
-
IR : Selon vous,
les spécificités longtemps peu modifiées du milieu culturel indo-créole
pourraient-elles disparaître en se fondant dans un ensemble culturel
plus large ? Lequel ("créole", "occidental"...) ?
JB : Peu modifiées ? Il
faut d’abord s’entendre à ce sujet. En effet, il ne faut pas oublier que
les immigrés de l’Inde ont très vite su s’adapter culturellement à leurs
nouveaux pays : langue, vêtement, activités professionnelles, et formes
d’insertion dans la société ont très tôt suivi un code créole
parfaitement maîtrisé. Cela leur a permis de réels succès ; il n’y a pas
eu de ghetto, même si l’hostilité de l’entourage rural a parfois été
grande.
Mais ces changements out-ils remis en cause l’essentiel, une vision
du monde, un rapport à la vie, à la mort à la famille, à l’argent, au
travail ? Sans doute, mais s’agit-il d’une érosion qui conduit à la
disparition d’un héritage, ou d’une façon d’adapter cet héritage à une
situation qui change ? Et les changements actuels sont-ils plus amples
que les anciens ? Mais par dessus tout : ces changements sont-ils une
menace ou un signe de vitalité ?
Toute culture, toute religion change, ou meurt. Malgré les
apparences. Même les religions qui se réfèrent à un grand livre
fondateur où elles voient le message divin changent : elles le font en
modifiant la lecture du texte, son interprétation, l’accent privilégié
sur telle ou telle de ses parties. Mais, comme un être vivant elles
changent dans la continuité de leur être.
Le seul risque serait la fixité, qui fait d’une religion vivante
une religion « en conserve », selon l’expression de Roger Bastide, en
conserve, donc morte.
Alors, dans la faible mesure où j’ai le droit de répondre à votre
question, je vous dirais qu’il y a convergence sans fusion, une
articulation avec ce monde plus vaste. Mais en se l’appropriant, donc
sans s’y fondre. A l’avenir de trancher !
-
IR : Et quel
regard portez-vous personnellement sur l'Inde, ce pays qui vous a très
tôt fasciné et qui actuellement s'est lancé dans la grande course
économique mondiale, au risque - diront certains - d'y perdre une âme
pourtant si longtemps préservée ?
JB : Le risque pour
l’Inde était de devenir une âme sans corps, tant la poursuite de sa
trajectoire des décennies précédentes aurait pu la conduire à un cul de
sac. Mais, s’il est me semble-t-il une leçon de l’histoire à retenir en
matière de développement, c’est que les grandes civilisations, même si
elles meurent, laissent sur le sol où elles ont vécu un terreau
suffisamment riche pour qu’un jour, sur ce même sol, chez les mêmes
gens, une autre civilisation renaisse. Tout se passe alors comme il en
va de ces plantes du désert qui fleurissent dès l’arrivée de la pluie
après des années de sécheresse. Le passé laisse des traces, laisse une
structure. Et, en Inde, le fait religieux, dont la pesanteur a sans
doute contribué à écraser le passé est sans doute l’un des ferments du
présent. Ce fait religieux était-il d’ailleurs si porteur d’une âme ? À
côté d’une Inde idéalisée, il y a toujours eu une Inde dure, une Inde où
la religion assurait le pouvoir des plus forts et la soumission des
autres. Pensons à la richesse de ceux qui prêchaient aux plus pauvres le
renoncement et le détachement ! Je ne crains pas le développement. Le
« matérialisme » que certains pourfendent ne peut-il pas être avant tout
la création des conditions matérielles d’un essor spirituel ?
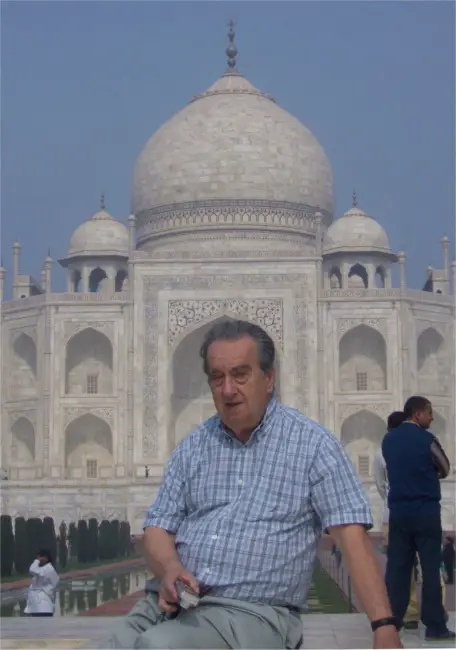
JB : Il s’est produit un
merveilleux renversement des relations. Quand je commençais à travailler
à La Réunion et à entrer dans ce milieu, j’étais avant tout demandeur.
Le temps a passé ; ce que je voyais de l’extérieur, je l’ai peu à
peu intériorisé. Les gens que je ne croyais qu’observer sont entrés dans
ma vie, et moi un peu dans la leur. Et le temps a encore passé ; les
anciens sont morts, leurs fils sont devenus des « vieux », et leurs
petits-fils sont maintenant des adultes. Apparemment éloignés du monde
de ces anciens, ils le cherchent, et ils me demandent de leur en parler.
Cela devient pour moi un nouveau projet, un projet très délicat car il
demande nuance et équilibre pour ne pas devenir un chantre nostalgique
d’un passé aboli, pour ne rien rejeter de ce qui fait le monde moderne
dans lequel tous vivent, mais pour suivre la rivière culturelle
souterraine à laquelle on peut toujours puiser quand la soif d’autre
chose monte en chacun.
Un projet de transmission, de transfusion. Il a déjà commencé ; à
plusieurs reprises on m’a invité, comme témoin, comme mémoire. Les
enregistrements des anciens poussari ont été écoutés avec ferveur dans
des salles où après la séance, certains jeunes venaient me voir et me
posaient des questions sur leur grand-père, me demandaient des photos
etc. J’ai ainsi collaboré tout récemment avec plaisir au n°7 de la revue
Tamij, en retrouvant quelques portraits de prêtres et en écrivant
quelques souvenirs à propos de l’un d’eux, Manicon, que j’ai beaucoup
apprécié par sa personnalité et par son accueil. Tout cela passe
maintenant par un échange assez dense de courriels qui font revenir à la
Réunion, d’une façon immatérielle assez émouvante, les images et les
paroles des anciens. Ce passé redevient un présent. Je ne refuse aucun
contact, aucune proposition, s’ils me permettent de déposer çà et là,
aux pieds de ceux qui se rattachent aux anciens que j’ai connus,
quelques fragments de leur message. Les petits-enfants s’intéressent
plus à leurs grands parents que les fils à leur père. Et ceux que j’ai
bien connus sont justement les grands parents de la génération
actuellement la plus active au cœur de la vie indo-créole. Alors, j’ai
le devoir de parole, du moins quand on me le demande. C’est là mon
principal projet. J’en ai aussi d’écriture, mais cela ne se dit et ne se
juge que lorsque le texte est sorti : il y a tant de projets d’écriture
qui sont restés dans les encriers !
|




